Les aéroports
Il y a des années de cela, je me trouvais à l’aéroport de Philadelphie, sur le point d’embarquer dans un avion en route vers le Japon, sans avoir alors la moindre idée de ce qui m’attendrait sur place. Je savais que j’allais dormir dans un foyer pour voyageurs étrangers, principalement des enseignants, mais ne savais pas à quoi il pourrait bien ressembler. J’ignorais s’il me serait difficile de trouver de la nourriture mangeable, des vêtements que je puisse porter, ou des gens que je puisse fréquenter. Je savais que le café était censé être hors de prix et que les rues étaient censées être absolument nickel, et c’était tout.
Depuis ce premier vol en partance pour le Japon, j’en ai emprunté beaucoup d’autres, de retour de courtes vacances après ma première longue période ici, revenant pour étudier, travailler ou voir des amis après quelques jours hors du Japon. Bien évidemment, lors de ces voyages de retour, je n’ai jamais plus éprouvé le même sentiment d’incertitude. Plus je passais de temps ici, plus ce pays perdait de son mystère et de ses surprises. Il devenait un endroit normal, pour moi. Je savais que le café n’était pas si cher ; les rues n’étaient pas toutes si nickel. Que les vêtements m’allaient bien souvent un peu mieux que la plupart des fringues que je peux trouver dans mon propre pays. Et je sais ce qu’on peut trouver ici comme nourriture, et c’est précisément l’une des raisons qui m’y font revenir. Je sais à quoi cela ressemble ici ; je sais à quoi m’attendre.
Mais l’autre jour, assis à l’aéroport de San Francisco, en attente du vol de retour, je me suis senti un peu comme la première fois quand je n’avais pas la moindre idée de ce qui m’attendait. Je ne sais pas quelles seront mes conditions de vie, ma nourriture, mes vêtements. Pour la première fois depuis toutes ces années, je retourne au Japon pour faire quelque chose de totalement différent de ce que j’ai pu faire jusqu’alors – en fait de ce que la plupart des gens n’ont jamais pu faire tout court.
Je viens au Japon pour devenir un lutteur de sumo.
Pas un véritable sumotori, bien sûr. Je n’en ferai partie que quelques semaines et ne combattrai pas en public. Mais ce ne sera pas non plus le simple fait de revêtir un costume de bibendum pour participer à une compétition d’étudiants. Je vais vivre et m’entraîner avec des sumotori pendant une semaine – et peut-être plus longtemps – pour être en mesure d’écrire sur cette expérience.
L’idée de ce projet, comme beaucoup de choses dans ma vie, est née de ma paresse. Les deux mastères que je mène de front – journalisme et civilisations extrême-orientales – impliquent tous deux la rédaction d’une thèse. Quand j’ai commencé à réfléchir là-dessus, j’ai essayé de trouver quelque chose qui puisse rassembler les deux matières, m’épargnant ainsi la peine de rédiger une deuxième thèse. Tous ceux à qui j’ai soumis cette idée en ont été extrêmement intéressés, bien que personne ne pense que je pourrai en fait trouver une « heya » de sumo, comme on appelle les centres d’entraînement, qui acceptera de m’accueillir.
Je m’investis progressivement dans ce projet. J’écris un article sur le sumo pour un cours d’histoire de la civilisation japonaise moderne. Je demande à des conseillers comment je pourrais faire pour que ce sujet soit pris en compte pour mes deux thèses. Je commence à demander comment je pourrai m’introduire dans une heya.
C’est la dernière chose à faire pour me remonter le moral. Un gars, diplômé de Berkeley en anthropologie après un doctorat obtenu sur le sujet du sumo m’assure que le type d’accès que je cherche à obtenir n’arrive qu’après de longues années à établir des relations. Aucun de ceux à qui je m’adresse ne semble avoir la plus petite idée de la façon de chercher une heya qui accepterait de m’accueillir. Mais je continue à demander.
Je ne veux pas donner l’impression que j’aborde cela avec l’obstination de celui qui a quelque chose à dire, et ne laisserait rien au monde se mettre en travers de son chemin. En fait, je ne fais que faire des requêtes polies, sans jamais trop croire qu’une heya m’accepterait, et fouine à la recherche de sujets de secours.
C’est alors que l’une de mes requêtes polies finit par payer. Je parle de mon idée avec Mariko, la journaliste du Yomiuri Shinbun, le premier journal d’information du Japon, venue à Berkeley pour enseigner le journalisme au printemps dernier. Elle me semble dubitative au premier abord, mais quelques semaines après que je lui eus fait part de mon idée, elle me surprend : « Alors, quand veux-tu partir ? », me demande-t-elle. Il s’avère que le chroniqueur sportif du Yomiuri a laissé entendre que c’était quelque chose qui pouvait être arrangé.
Maintenant que cela semble en bonne voie pour se réaliser, je commence à en parler à mes profs de journalisme, qui me paraissent aussi enthousiastes que tous les autres auxquels j’en avais parlé. « Vous avez mis en pleine lucarne », me dit d’ailleurs l’un d’eux. Le fait que l’idée m’en soit venue par fainéantise n’en fait apparemment pas forcément une mauvaise idée.
Il y a deux mois, Mariko m’envoie un e-mail pour me faire savoir que le maître de la Hanaregoma heya me prendrait à l’essai pour huit à dix jours, plus si je fais une bonne impression. Maintenant que tout semble arrangé, j’établis une liste d’ouvrages à compulser et rassemble les noms des personnes que je souhaite interviewer : professeurs d’université, chroniqueurs sportifs, ex-lutteurs, et membres des instances du sumo. Je fais également à la muscu, pour éviter d’être broyé durant les séances au sein de la heya.
Mon programme est d’ailleurs assez efficace. Quand j’en ai fini, je peux soulever des poids presque corrects et il est même quelques personnes qui notent que je semble plus en forme.
Les préparations journalistiques, toutefois, sont loin d’être autant couronnées de succès. Juste après avoir appris que la Hanaregoma heya est à même de m’accueillir, je suis submergé par une vague de travail scolaire et de cours à donner qui m’empêchent de me concentrer su mon projet de sumo. Je me débrouille pour lire quelques ouvrages et articles, mais c’est à peu près tout. Je vais arriver dans la heya, et j’espère que les lutteurs, chez qui j’emménage demain, ne vont pas me prendre pour un abruti à me voir lire toute la journée.
Tout ça pour dire que suis dramatiquement mal préparé pour ce que je suis sur le point de faire : un reportage à la première personne sur la vie au milieu de lutteurs de sumo qui n’ait pas un vague air de « ce que j’ai fait pendant mes vacances de Noël » et donne un véritable éclairage sur le sumo, mais aussi sur le Japon lui-même.
Je ne suis pas en train de dire que je vais me mêler aux lutteurs pour avoir une sensation du « vrai Japon ». Mis à part l’habituelle association faite entre le sumo et les traditions japonaises, je ne crois pas que ce sport ne représente en aucun cas un quelconque « vrai Japon », loin de là en fait. Selon les études les plus sérieuses que j’ai pu lire à ce sujet en fait, ce que nous connaissons aujourd’hui comme le sumo est une création de la fin du 17° siècle, quand des promoteurs de combats de rue travestirent ceux ci d’atours religieux pour les rendre tolérables par les régimes militaires du Japon de l’époque. Bien sûr, trois siècles, c’est une paye, mais ça n’est rien comparé au millénaire prêté au sumo par ceux qui y voient l’incarnation de l’Esprit Japonais.
D’un autre côté, cette entreprise de légitimation multi-séculaire du sumo a été tant couronnée de succès que les gens le considèrent réellement aujourd’hui comme l’incarnation de cet Esprit. Et porter un regard sur le Japon à partir d’une institution dans laquelle ce pays a placé l’essence de son esprit national ne peut être que révélateur.
Il y a des sujets que j’espère pouvoir aborder et décrire dans mon reportage final. Pour l’instant, continuez à suivre ces compte-rendus sur ce que peut être la vie au milieu de lutteurs de sumo. Et bien entendu, j’attends avec impatience vos commentaires, questions, critiques ou autres. Envoyez-moi un e-mail à : adelmanj@berkeley.edu.
APRÈS: L’Oyakata, le Kashira et Iki
Depuis ce premier vol en partance pour le Japon, j’en ai emprunté beaucoup d’autres, de retour de courtes vacances après ma première longue période ici, revenant pour étudier, travailler ou voir des amis après quelques jours hors du Japon. Bien évidemment, lors de ces voyages de retour, je n’ai jamais plus éprouvé le même sentiment d’incertitude. Plus je passais de temps ici, plus ce pays perdait de son mystère et de ses surprises. Il devenait un endroit normal, pour moi. Je savais que le café n’était pas si cher ; les rues n’étaient pas toutes si nickel. Que les vêtements m’allaient bien souvent un peu mieux que la plupart des fringues que je peux trouver dans mon propre pays. Et je sais ce qu’on peut trouver ici comme nourriture, et c’est précisément l’une des raisons qui m’y font revenir. Je sais à quoi cela ressemble ici ; je sais à quoi m’attendre.
Mais l’autre jour, assis à l’aéroport de San Francisco, en attente du vol de retour, je me suis senti un peu comme la première fois quand je n’avais pas la moindre idée de ce qui m’attendait. Je ne sais pas quelles seront mes conditions de vie, ma nourriture, mes vêtements. Pour la première fois depuis toutes ces années, je retourne au Japon pour faire quelque chose de totalement différent de ce que j’ai pu faire jusqu’alors – en fait de ce que la plupart des gens n’ont jamais pu faire tout court.
Je viens au Japon pour devenir un lutteur de sumo.
Pas un véritable sumotori, bien sûr. Je n’en ferai partie que quelques semaines et ne combattrai pas en public. Mais ce ne sera pas non plus le simple fait de revêtir un costume de bibendum pour participer à une compétition d’étudiants. Je vais vivre et m’entraîner avec des sumotori pendant une semaine – et peut-être plus longtemps – pour être en mesure d’écrire sur cette expérience.
L’idée de ce projet, comme beaucoup de choses dans ma vie, est née de ma paresse. Les deux mastères que je mène de front – journalisme et civilisations extrême-orientales – impliquent tous deux la rédaction d’une thèse. Quand j’ai commencé à réfléchir là-dessus, j’ai essayé de trouver quelque chose qui puisse rassembler les deux matières, m’épargnant ainsi la peine de rédiger une deuxième thèse. Tous ceux à qui j’ai soumis cette idée en ont été extrêmement intéressés, bien que personne ne pense que je pourrai en fait trouver une « heya » de sumo, comme on appelle les centres d’entraînement, qui acceptera de m’accueillir.
Je m’investis progressivement dans ce projet. J’écris un article sur le sumo pour un cours d’histoire de la civilisation japonaise moderne. Je demande à des conseillers comment je pourrais faire pour que ce sujet soit pris en compte pour mes deux thèses. Je commence à demander comment je pourrai m’introduire dans une heya.
C’est la dernière chose à faire pour me remonter le moral. Un gars, diplômé de Berkeley en anthropologie après un doctorat obtenu sur le sujet du sumo m’assure que le type d’accès que je cherche à obtenir n’arrive qu’après de longues années à établir des relations. Aucun de ceux à qui je m’adresse ne semble avoir la plus petite idée de la façon de chercher une heya qui accepterait de m’accueillir. Mais je continue à demander.
Je ne veux pas donner l’impression que j’aborde cela avec l’obstination de celui qui a quelque chose à dire, et ne laisserait rien au monde se mettre en travers de son chemin. En fait, je ne fais que faire des requêtes polies, sans jamais trop croire qu’une heya m’accepterait, et fouine à la recherche de sujets de secours.
C’est alors que l’une de mes requêtes polies finit par payer. Je parle de mon idée avec Mariko, la journaliste du Yomiuri Shinbun, le premier journal d’information du Japon, venue à Berkeley pour enseigner le journalisme au printemps dernier. Elle me semble dubitative au premier abord, mais quelques semaines après que je lui eus fait part de mon idée, elle me surprend : « Alors, quand veux-tu partir ? », me demande-t-elle. Il s’avère que le chroniqueur sportif du Yomiuri a laissé entendre que c’était quelque chose qui pouvait être arrangé.
Maintenant que cela semble en bonne voie pour se réaliser, je commence à en parler à mes profs de journalisme, qui me paraissent aussi enthousiastes que tous les autres auxquels j’en avais parlé. « Vous avez mis en pleine lucarne », me dit d’ailleurs l’un d’eux. Le fait que l’idée m’en soit venue par fainéantise n’en fait apparemment pas forcément une mauvaise idée.
Il y a deux mois, Mariko m’envoie un e-mail pour me faire savoir que le maître de la Hanaregoma heya me prendrait à l’essai pour huit à dix jours, plus si je fais une bonne impression. Maintenant que tout semble arrangé, j’établis une liste d’ouvrages à compulser et rassemble les noms des personnes que je souhaite interviewer : professeurs d’université, chroniqueurs sportifs, ex-lutteurs, et membres des instances du sumo. Je fais également à la muscu, pour éviter d’être broyé durant les séances au sein de la heya.
Mon programme est d’ailleurs assez efficace. Quand j’en ai fini, je peux soulever des poids presque corrects et il est même quelques personnes qui notent que je semble plus en forme.
Les préparations journalistiques, toutefois, sont loin d’être autant couronnées de succès. Juste après avoir appris que la Hanaregoma heya est à même de m’accueillir, je suis submergé par une vague de travail scolaire et de cours à donner qui m’empêchent de me concentrer su mon projet de sumo. Je me débrouille pour lire quelques ouvrages et articles, mais c’est à peu près tout. Je vais arriver dans la heya, et j’espère que les lutteurs, chez qui j’emménage demain, ne vont pas me prendre pour un abruti à me voir lire toute la journée.
Tout ça pour dire que suis dramatiquement mal préparé pour ce que je suis sur le point de faire : un reportage à la première personne sur la vie au milieu de lutteurs de sumo qui n’ait pas un vague air de « ce que j’ai fait pendant mes vacances de Noël » et donne un véritable éclairage sur le sumo, mais aussi sur le Japon lui-même.
Je ne suis pas en train de dire que je vais me mêler aux lutteurs pour avoir une sensation du « vrai Japon ». Mis à part l’habituelle association faite entre le sumo et les traditions japonaises, je ne crois pas que ce sport ne représente en aucun cas un quelconque « vrai Japon », loin de là en fait. Selon les études les plus sérieuses que j’ai pu lire à ce sujet en fait, ce que nous connaissons aujourd’hui comme le sumo est une création de la fin du 17° siècle, quand des promoteurs de combats de rue travestirent ceux ci d’atours religieux pour les rendre tolérables par les régimes militaires du Japon de l’époque. Bien sûr, trois siècles, c’est une paye, mais ça n’est rien comparé au millénaire prêté au sumo par ceux qui y voient l’incarnation de l’Esprit Japonais.
D’un autre côté, cette entreprise de légitimation multi-séculaire du sumo a été tant couronnée de succès que les gens le considèrent réellement aujourd’hui comme l’incarnation de cet Esprit. Et porter un regard sur le Japon à partir d’une institution dans laquelle ce pays a placé l’essence de son esprit national ne peut être que révélateur.
Il y a des sujets que j’espère pouvoir aborder et décrire dans mon reportage final. Pour l’instant, continuez à suivre ces compte-rendus sur ce que peut être la vie au milieu de lutteurs de sumo. Et bien entendu, j’attends avec impatience vos commentaires, questions, critiques ou autres. Envoyez-moi un e-mail à : adelmanj@berkeley.edu.
APRÈS: L’Oyakata, le Kashira et Iki
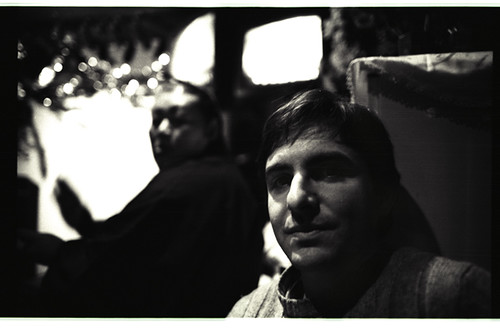


<< Home