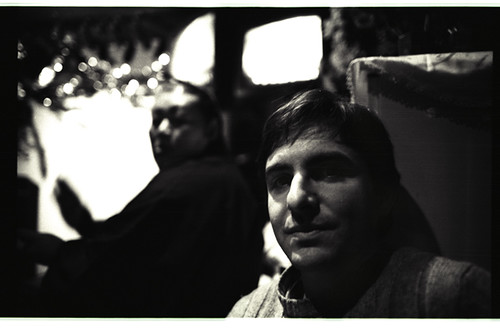Me voici donc, seul dans la chambre à l’étage, en train de fureter dans les photos d’Iki. Alors que je suis sur le point de les reposer et de regagner mon petit coin, je remarque l’image plastifiée collée sur sa mallette métallique. On dirait une publicité, qui le met en scène en train de tenir une bouteille de champagne et d’effectuer une variante de sa pose de « geisha boy ». au moment où j’essaye de déchiffrer les idéogrammes de la photo, j’entends du monde monter les escaliers. Je me précipite sur mon couchage et m’étends, faisant mine de lire un livre.
Le kashira fait son entrée, suivi d’Ishikawa toujours en mawashi et porteur d’une pile de vêtements du premier, pliés impeccablement. Ishikawa place doucement les vêtements sur un tapis au sol, tandis que le kashira s’assied et allume une cigarette. Il me demande ce que je suis en train de lire.
« c’est un livre sur la boxe ». Il répond d’une phrase en japonais qui peut se traduire littéralement par ‘ça pue comme un vieux’. Il veut dire que mon bouquin a l’air sérieux, quelque chose que seul un ancien pourrait lire.
« C’est assez intéressant », lui réponds-je.
Le kashira grommelle, mais Ishikawa l’interromps. « le kashira a des armoires pleines de livres sérieux », me dit-il.
Puis le kashira me demande si j’ai déjà vu un film de yakuza. Je lui cite quelques-uns uns des films de Kurosawa que j’ai pu voir, mais ce n’est pas la réponse qu’il attend. « Vous connaissez Akira Kobayashi ? », me demande-t-il.
Devant ma réponse négative, il me cite un titre de film qu’il pense que je devrais voir. Pendant ce temps, il s’est débarrassé de ses vêtements pour aller se baigner, et ne porte plus qu’une serviette autour de la taille. Il disparaît derrière la porte coulissante et je replonge dans mon bouquin. Peu de temps après, Iki est de retour. Il se déshabille rapidement, s’enroule d’une serviette et descend au rez-de-chaussée.
Il faut que je vous dise qu’il y a quelques interdits que je doit respecter au sein de la heya, en tant qu’invité. L’un est que je ne peux être assis avec les pieds faisant face au dohyo. Et un autre est que je ne peux aller me baigner avant que l’oyakata, le kashira et le sekitori n’y soient eux-même allés. Ils préfèrent aller se baigner seuls – ou, dans le cas du sekitori, avec un tsukebito – et nul n’oserait contester ce privilège à aucun d’entre eux. Mais en l’espèce, il semble que c’est exactement ce que Iki vient de faire, en y allant précisément durant le bain du kashira. Comment peut-il s’en tirer comme cela ? Je me pose encore la question. Il est facile de s’imaginer qu’il fait partie du crime organisé ; peut-être est-il un membre de l’élite des yakuza, dont la position surclasse celle de tout autre membre de la heya.
Il revient dix minutes après, remettant les habits dans lesquels il était arrivé : short écossais et T-shirt rouge sur lequel est brodé, en caractères blancs, le mot ‘AI’, ce qui veut dire ‘amour’. Il y avait écrit ‘DAVID’, mais il a enlevé le D,V,D, me dit-il.
Une fois qu’il s’est assis, je montre du doigt son attaché-case avec cette étrange publicité et lui demande « Est-ce vous ? »
« Oui », me dit-il, en pointant les deux premiers caractères chinois en haut de la page.
« Je ne sais pas lire cela », lui dis-je.
« Baishu », me lit-il. Je lui réponds que j’ignore ce dont il s’agit.
« La lessive, tu vois ? ». Je crois, en effet. « Lessive » est aussi le diminutif pour « Pays de la Lessive », aussi connu comme « Les Bains Turcs ». C’est une forme de prostitution existant au Japon, qui consiste à se faire récurer le corps par une femme nue et recouverte de mousse. J’ignore précisément ce que cela peut impliquer d’autre, je ne peux qu’imaginer les choses les moins ragoûtantes.
Mais avant qu’il n’ait pu m’expliquer ce que lui et sa bouteille de Moet font là dedans, le kashira fait son entrée. Iki arrête ses explications et devient silencieux. Une certaine tension règne dans la pièce, et j’ai vraiment envie de sortir. Maintenant que le kashira est hors de la salle de bains, je sais que je peux aller me baigner et me mets donc à la recherche de ma serviette, que je n’arrive pas à trouver.
Je finis enfin par la trouver, enroulée autour de la taille d’Iki ; il a du la piquer sur la pile de mes vêtements avant d’aller se baigner. Je partagerais sans problèmes ma serviette avec n’importe quel autre lutteur de la heya, mais je ne peux que penser aux maladies honteuses dont peux souffrir Iki. Fort heureusement, le kashira finit par me demander ce que je cherche et, devant ma réponse, ordonne à Ishikawa d’aller m’en chercher une propre.
Après mon bain, je descends en bas pour aller goûter le mochi préparé par les lutteurs. Sans conteste, c’est le meilleur que j’aie jamais mangé : frais, tout chaud, moelleux sans être caoutchouteux. L’épouse du kashira, sa fille et un de ses petits-fils ont œuvré avec un ami de la famille, moulant le mochi en des boules oblongues et le découpant en morceaux. Ils le servent sous des piles de daikan moulu, de haricots noirs sucrés, de poudre de soja doux et de natto. Tout, sauf le natto que j’évite, est délicieux. Bien calé, je remonte pour passer le temps en attendant le bon-en-kai, pendant que les lutteurs font la sieste.
Le bon-en-kai est comme une soirée de Nouvel An, sauf que cela ne tombe pas au Nouvel An. Le nom signifie littéralement « Oublies la soirée du Nouvel An », et si l’on considère ce que l’on ingurgite lors d’un bon-en-kai typique, on risque en effet d’oublier une bonne partie de l’année.
L’une des raisons pour lesquelles je reste au sein de la heya plus longtemps que je ne l’avais envisagé est d’être présent pour le bon-en-kai. Au départ, l’oyakata m’a dit que pour avoir les impressions que je recherchais, une dizaine de jours seraient suffisants. Il a ajouté que je pourrais rester plus longtemps si je le désirais, mais j’ai compris cela comme une forme de politesse. Donc je pensais quitter la heya deux jours après Noël, ce qui m’aurait fait dix nuits.
Puis, vers la fin de mon séjour, les lutteurs ont commencé à me demander si je serais là pour le bon-en-kai, me disant que ce serait sympa. J’étais flatté qu’ils souhaitent que je sois présent, et me dit qu’il serait pas mal de les voir en dehors du contexte de la heya, avec un petit peu d’alcool dans le sang. En outre, j’y voyais un bon moyen de conclure cette expérience. Quand je demandai à l’oyakata si je pouvais rester quelques nuits de plus, il m répondit « Pas de problèmes ».
Une fois les lutteurs éveillés de leur sieste, ils commencent à s’habiller en vêtements de sumotori – sous-vêtements, kimonos, ceintures – en prélude à la soirée ; Iki se change aussi, dans une costume gris brillant, une chaîne en or autour du cou, en dessous de sa cravate. Cela fait une heure qu’il s’acharne sur ses téléphones portables, sans que je comprenne bien ce qu’il fait, mais je l’entends prononcer pas mal de diminutifs féminins : Tomoko-san, Hiromi-san, Etsuko-san. Peut-être est-il en train de rechercher des hôtesses –ou des strip-teaseuses – pour le bon-en-kai, me dis-je. Peut-être vais-je enfin comprendre ce que ce gars fait ici.
Je suis le troupeau hors de la heya, au point de rendez-vous convenu, près de la gare. Il s’avère qu’il s’agit d’un snack-bar au sous-sol d’un centre commercial. Les snacks-bars du Japon ne sont pas des revendeurs de hot dog et de soda, mais plus de petits bars, avec une clientèle principalement masculine. Ils sont en général pourvus de karaokés avec une large sélection de ‘enka’, des chansons mélos d’amour perdus et de rêves brisés. Un enka très populaire a par exemple comme refrain ‘laisses moi gagner de l’argent avant de me quitter’.
Les snacks bar sont en général tenus par de belles, bien qu’âgées, propriétaires et parfois par un personnel plus jeune et soigneux. Le snack où nous nous trouvons est, lui, vide, loué pour la soirée de la heya : l’endroit rêvé pour une orgie sumoïstique que je soupçonne Iki d’avoir préparé.
Nous pénétrons dans le petit bar. Je jette un oeil au long canapé en vinyle qui court sur toute la longueur du bar, en-dessous d’un grand miroir. Hiroki et Batto s’asseyent à mes côtés à une table. Un karaoké se trouve en face du bar, décoré à l’hawaïenne.
Personne ne parle. Un gars en chemise blanche et cravate noire sort de la cuisine et place quelques assiettes de sushi sur les tables. Je m’assieds confortablement, attendant que la folie commence.
Puis, soudain, tout le monde se lève. ‘Otsukarisandegozaimasu !’, gueulent-ils tous ensemble à l’entrée de l’oyakata. Tenant son petit-fils par la main, il arrive encadré par son épouse et sa fille. La soirée devrait être bien plus calme que ce à quoi je pouvais m’attendre.
Et en effet, elle l’est. Non seulement ils n’y a pas de putes, mais les lutteurs boivent à peine, la plupart sirotant un thé oolong après s’être enfilé leur bière réglementaire, pendant laquelle le sekitori exprime à chacun son souhait de le voir avancer dans le banzuke.
Mais cette fête me donne effectivement le sentiment d’achèvement que je recherchais. C’est en quelque sorte la réunion de tous les personnages que j’ai rencontrés ces deux dernières semaines. Tout le monde est présent : les lutteurs, le coiffeur, le gyoji chauve, le yobidashi venu aider à la confection du dohyo.
Le kashira converse avec le sekitori, qui tapote machinalement avec un éventail sur la nuque de Kazuya. Murayoshi sermonne Hiroki parce qu’il chante trop bas, de la même façon qu’il le faisait pour lui reprocher la veille de s’être fait projeter au sol à l’entraînement. « Je suis désolé » réponds Hiroki avec déférence. Je regarde Iki passer de tables en tables, bavassant avec tout le monde, servant des boissons, jouant avec le petit-fils de l’oyakata.
Finalement, mon tour vient de chanter au karaoké. Je demande ‘back in the USSR’ et occupe la scène, massacrant le ‘Georgia’s really on ma-ma-ma-ma-ma-ma-mind’. Après ma chanson, Moriyasu m’appèle à la table du kashira, qui essaye de me donner une liasse de billets de 1000 yens pliés ensemble. J’avais remarqué qu’il donnait quelque chose aux lutteurs après leurs chanson, mais ne pouvait dire quoi.
« C’est pour quoi faire ? » demandé-je à Moriyasu.
« Pour les chansons. Tous ceux qui chantent reçoivent de l’argent. Cela fait partie du bon-en-kai »
« Je ne peux pas accepter »
« Mais si, tu peux. Tu dois, tu as chanté »
« Désolé, c’est impossible ». Moriyasu a l’air blessé. Il laisse tomber, mais le kashira me tend à nouveau les billets. « C’est pour les chansons »
« Merci, mais je suis désolé, je ne peux accepter »
« Pourquoi ? », me demande-t-il, intrigué.
« Je suis journaliste », lui dis-je, plus grandiloquent que je ne veux en avoir l’air. Le jeune gyoji, Kichijiro, parvient à lui expliquer ce que cela implique, et on me laisse en paix.
« Mais je vais prendre un peu de ça », dis-je, en montrant la bouteille de sho-chu qu’ils sont en train de partager. Le kashira m’en verse une rasade, qui s’avère être une liqueur semblable à une vodka allongée au café. C’est excellent.
Je passe le reste de la soirée à boire du sho-chu avec le kashira, Kichijiro et Ishikawa, écoutant les lutteurs chanter des chansons populaires, tandis que les plus vieux entonnent des enka de solitude et de désespoir. Puis nous revenons tous à la heya.
APRÈS:
Portraits de sumotori 3