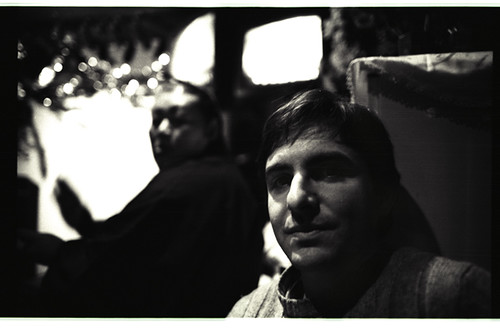Les lendemain de la session d'entraînement des lutteurs devant le conseil de promotion des yokozuna, Miki, le journaliste du Yomiuri qui a arrangé mon séjour au sein de la heya – et que je n'ai toujours pas rencontré en personne – m'envoie un e-mail. Il m'écrit que la NSK doit tenir un dohyo-matsuri ce samedi matin pour sanctifier le cercle sacré du Kokugikan avant le début du tournoi de Janvier. Il m'invite à passer et me dit que nous nous rencontrerons sur place.
J'arrive en retard, pour trouver une petite foule déjà tassée contre les cordes délimitant l'entrée du complexe. Certains sont munis d'appareils photos et se tordent le cou pour tenter d'avoir une vue dégagée sur quiconque pourrait franchir les portes. Posées contre ces dernières, deux énormes portraits de lutteurs, que je reconnais pour les avoir vus dans le magazine de sumo que j'ai acheté quelques jours plus tôt.
L'un est Kaio, représenté debout, ses bras très musclés pendant sur le côté; L’autre est le Mongol Asashoryu, représenté penché, en train d'effectuer un shiko très travaillé. Tous deux portent le tablier richement décoré, le kesho-mawashi, signe distinctif de leur rang. Asashoryu porte en outre une large corde autour de la taille, sur laquelle pendent des motifs de papier en forme d'éclairs, qui retombent sur ses cuisses repliées. La corde et les éclairs sont le signe de sa condition de yokozuna.
Ces portraits, apprendrai-je plus tard, symbolisent les victoires des lutteurs dans les tournois de l'année précédente. Asashoryu en a gagné cinq, Kaio un seulement.
Tout d'abord je pensais que la foule attendait pour entrer voir le dohyo-matsuri, mais de temps à autres un garde fait entrer quelqu'un à l'intérieur, en lui faisant traverser la foule. Je commence à craindre de rater la cérémonie à l'intérieur, et je me dirige donc vers une entrée de service à travers la salle de musée, et pénètre à l'intérieur sans être arrêté. J'aperçois un garde et lui demande où se tient le dohyo-matsuri; il me montre trois portes attenantes. J'imagine que c'est à mon costume-cravatte que je dois cette entrée particulièrement libre.
Je pénètre dans l'énorme salle de lutte. Le dohyo s'y trouve au centre, monté sur un amas de terre trapézoïdal à peine plus large que le cercle sacré lui-même. Un toit en bois de style shinto est suspendu au-dessus du dohyo, des fourragères de couleur rouge, blanche, noire et vertes accrochées à chaque coins. Elles représentent les quatre saisons, les quatre points cardinaux ou les quatre divinités mythologiques, selon diverses sources. Mais personne ne conteste qu'elles symbolisent au moins les quatre piliers qui supportaient autrefois le baldaquin.
Jusqu'au vingtième siècle, les matches de sumo se tenaient en extérieur, souvent sur des dohyo surmontés de baldaquins qui protégeaient les lutteurs de la pluie et de la neige. Quand le sumo commença à se tenir au Kokugikan (littéralement 'centre sportif national') construit exprès à cet usage en 1909, le toit fit son entrée à l'intérieur. Désormais, les matches se jouant en salle, ce toit n'avait plus d'utilité pratique, et les piliers qui le supportaient gênaient la vision des spectateurs. Donc, dans les années 30 (ou 50, selon les sources), les fourragères ont remplacé les piliers.
Le baldaquin en lui-même, en attendant, fut construit sur le modèle des toits des temples shintos. J'ai lu qu'il aurait en particulier une grande ressemblance avec le toit du temple d'Ise, dans la préfecture de Mie. Ce temple est dédié à la déesse du Soleil qui, selon les mythes ancestraux japonais, a crée la lignée impériale. Cela en fait l'un des sites religieux les plus importants du pays. Mais bien que le temple d'Ise ait été construit il y a des milliers d'années, il n'a inspiré les toitures du sumo que depuis les années trente, quand il fut introduit au Kokugikan pour lui donné un aspect plus traditionnellement nippon. Avant cela, le baldaquin avait pour modèle des toitures de fermes célèbres de la campagne japonaise.
Autour du dohyo se trouvent deux rangées de sièges. La plus basse consiste en des coussins posés au sol, avec quinze gradins de boxes s'élevant progressivement. Chaque box est tout juste assez large pour contenir quatre personnes, et quatre coussins divisent en quartiers le sol recouvert de moquette orange. Devant les rangées de boxes, quelques rangées de coussins posés directement au sol autour du dohyo. Le balcon extérieur surplombe les boxes éloignés et consiste en une quinzaine de rangées de sièges pliables rouges.
Quelques spectateurs, la plupart des solitaires s'étant réservé un box pour eux seuls, contemplent le dohyo-matsuri, qui semble reproduire le même schéma que celui que j'ai vu dans la heya. Mais cette cérémonie est plus élaborée, trois gyoji exécutant les rituels, chacun d'entre eux semblant bien plus religieux que Hage-san. Au contraire du splendide costume de Hage-san, leurs chapeaux et kimonos sont strictement identiques à ceux portés par les véritables prêtres shintos. Le gyoji en chef, qui déclame les prières, porte un kimono doré; les deux autres, des kimonos blancs.

Autour du dohyo se trouvent de nombreux oyakata et autres institutionnels du sumo, en costumes sombres. Ils partagent le sake et autres offrandes, tout comme les lutteurs le faisaient à la heya.
A la fin de la cérémonie, je suis toute cette petite assemblée dehors, où la foule amassée autour de l'entrée principale est maintenant nombreuse. Peu après, Kaio et Asashoryu émergent du bâtiment en kimono traditionnel. Je reconnais le visage poupin de Kaio que j'ai vu devant le conseil de promotion des yokozuna. Mais je n'ai encore jamais vu Asashoryu de près, et suis très surpris de constater combien il paraît jeune avec son visage rondouillard.

Un vieux Japonais leur remet cérémonieusement une reproduction plus petite des portraits géants devant lesquels ils se trouvent. Je ne reconnais pas le vieux, mais imagine qu'il doit être membre de la NSK ou représentant du journal Mainichi, qui a commandé les portraits. Au moment où il remet son portrait à Asashoryu, une petite grand-mère japonaise devant moi fait remarquer, avec un rien d'aigreur dans la voix, à une autre petite vieille : « Il est rentré de Mongolie juste la semaine dernière ».
Puis les deux lutteurs se rapprochent l'un de l'autre et se serrent la main devant les appareils photo que tout un chacun dans la foule semble avoir. « Vas-y Kaio » crie la vieille devant moi.

De fait, à un jour du début du tournoi, la question qui semble être sur toutes les lèvres des fans de sumo est de savoir si Kaio fera une performance suffisante pour être promu yokozuna ce tournoi. Les fans japonais, ais-je pu lire, sont lassé d'avoir un étranger qui domine au sommet de leur sport national. Ils veulent un yokozuna japonais.
Mais, pour l'instant, Kaio n'a pas la cote. Il a perdu plusieurs matches contre des lutteurs moins bien classé durant le conseil de promotion des yokozuna – j'ai même vu à ce moment l'un des oyakata présents le réprimander publiquement pour concéder tant de défaites, même si j'ignore qui il était.
Quelques fans et commentateurs rejettent la responsabilité de la piètre performance de Kaio sur Asashoryu. Le yokozuna a manqué la session, selon son oyakata parce qu'il est rentré de Mongolie avec un rhume. Kaio a perdu beaucoup de matches parce qu'il a du compenser la fainéantise d'Asashoryu et combattre beaucoup plus qu'il n'aurait eu autrement à le faire, ont dit certains.
Le sentiment sous-jacent dans beaucoup de commentaires de fans est un ressentiment sur le fait que Asashoryu ait quitté le Japon pendant les vacances de Nouvel An.
« C'est une tradition séculaire dans le monde du sumo que les sumotori patientent et ne prennent leurs vacances de Nouvel An qu'après la fin du tournoi de Janvier » écrit un commentateur de l'Asahi. « Si Asashoryu perd de nombreux combats [à cause de sa maladie], il devrait recevoir les critiques qu'il mérite ».
Je ne pense pas que cette amertume vienne du ressentiment provoqué par l'absence de yokozuna japonais. Je crois plutôt que les Japonais voient en Asashoryu quelqu'un qui ne remplit pas les exigences attachées à son rang.
Les sumotori s'habillent comme les japonais des siècles passés, s'entourent des emblèmes de la religion nationale et suivent les us et coutumes du Japon traditionnel avec bien plus d'entrain que le reste de la population. Dans tout cela, ils sont comme une quintessence d'une forme exacerbée de « nipponisme ». Par conséquent, l'unique champion se doit d'être exemplaire sur le plan de l'attitude japonaise, qu'il soit lui-même japonais ou pas. Passer outre l'entraînement pré-tournoi après s'être barré en Mongolie n'est pas quelque chose que peut faire un yokozuna, peut-on imaginer lire en filigrane.
Quoi qu'il en soit, la cérémonie achevée, la foule se disperse et les cordes sont enlevées. Je retourne à l'intérieur du Kokugikan pour tuer le temps en attendant des nouvelles de Miki, dont j'attends le coup de fil.
APRÈS:
L'Eko-in