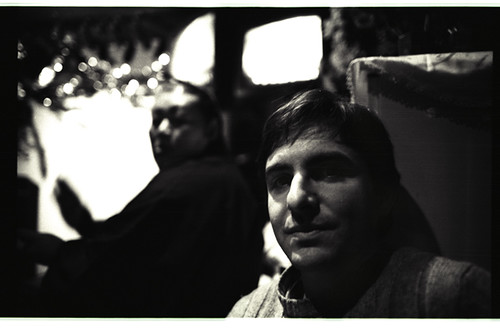Le Sumo, archétype de la pyramide sociale
Cette marche vers un Japon plus égalitaire, moins ancré dans ses hiérarchies immuables, est la plupart du temps considéré comme un bienfait. Les quelques bonnes nouvelles que l’on entend ces temps-ci au sujet de l’économie japonaise sont des success stories d’entreprises qui ont laissé tomber leurs structures de commandement rigides pour se mettre à l’écoute de leurs jeunes créateurs et pouvoir recruter à l’extérieur.
Mais dans le monde du sumo, la rigidité qui disparaît de la vie japonaise moderne est encore prégnante. Elle ne détermine pas uniquement le titre de celui auquel on s’adresse ; elle détermine la qualité même de la vie de tout un chacun. Votre rang dans la hiérarchie sociale détermine si vous allez baigner ou être baigner ; faire la cuisine ou être servi ; être sujet aux bastonnades intempestives, ou les administrer vous-même.
Cette rigidité a aussi un but très pragmatique, je pense. Elle amène une incitation très concrète aux petits à devenir plus gros, plus fort et plus hargneux pour pouvoir progresser dans la hiérarchie et échapper aux servitudes du sekitori. Et plus une heya a de lutteurs haut classés, plus elle a de prestige et d’argent.
Je parierais que, une fois qu’on le connaît vraiment, le sekitori n’est sans doute pas un mauvais bougre. Sans doute passe-t-il autant de temps cloîtré seul dans sa chambre parce qu’il en amarre d’être une crevure. Etre responsable de la torture et de l’humiliation d’un amas d’athlètes boursouflés n’est pas une sinécure. Mais cela fait partie du boulot et des prérogatives se rattachant à son rang.
J’imagine que le sekitori est sympa avec moi parce qu’il peut l’être. Je ne fais pas partie de la hiérarchie qui détermine la vie sociale de la heya. En mettant au point ce projet, je voulais être traité comme une jeune recrue. Je m’aperçois maintenant que c’était totalement impossible. Humilier un étranger tel que moi mettrait en péril le pouvoir symbolique d’humiliation habituellement utilisé.
Je réalise également à présent que, pour mon étude, la position que j’occupe, hors hiérarchie, est préférable à celle d’un apprenti. Elle me donne accès à des choses que ne peuvent connaître aucun des autres résidents. Je peux aller partout : sortir avec mes camarades haut classés, me faire offrir le dîner par le kashira, papoter avec le sekitori, ou regarder des émissions de variété dans la salle commune avec les jeunes lutteurs mal classés.
Mais ces derniers, par exemple, ne peuvent pas venir dans la chambre où je dors pour taper la discute avec mes camarades de chambrée. Et le sekitori ne peut pas passer un moment dans la pièce commune avec les mal classés pour regarder la télévision, du moins sans les maltraiter un peu au moins. Chacun doit rester au sein de sa caste.
Il est en fait assez étrange qu’une hiérarchie si rigide existe dans le monde du sumo. Ce sport est né d’un milieu rétif aux castes, le « demi-monde underground » du Japon des 17° et 18° siècles. Ce monde coexistait avec son pendant officiel, le Japon du shogunat de l’ère Edo.
Le Japon des shogun, posé sur son socle confucianiste, possédait des structures sociales parmi les plus codifiées. Une hiérarchie rigide le divisait entre les dirigeants du Japon, ses nobles, ses fermiers, les citadins et marchants formant la base de la pyramide. Des règles de comportement très strictes réservaient les artisanats les plus élaborés et les couleurs les plus chatoyantes aux détenteurs du prestige le plus élevé, tandis que les interdictions de déplacements limitaient la mobilité géographique.
Pour encore plus dominer cette stricte organisation sociale, le shogun empêchait aussi sa noblesse féodale – les samurai – d’accroître leur puissance en contraignant ses membres à passer le plus clair de leur temps à Edo, aujourd’hui Tokyo, où il pouvait les avoir à l’œil. Leur présence dans la cité développa une classe marchande de plus en plus nombreuse pour pouvoir satisfaire à leurs besoins somptuaires. Vers le milieu du 18° siècle, cet amoncellement de samurai et de citadins ordinaires avait fait d’Edo la ville la plus grande au monde.
Et que se passe-t-il lorsque l’on entasse derrière les grilles d’une cité des samurai blasés et des nouveaux riches ? Dans le cas d’Edo, ce fut une demande exponentielle pour des bordels, demande à laquelle le shogunat répondit en établissant un quartier chaud « officiel » aux portes de la cité, là où il poserait le moins de désagréments à l’ordre social établi. Un gigantesque quartier de loisirs s’établit alors autour de la zone des bordels, des zones semblables naissant autour des quartiers chauds des périphéries des autres villes japonaises. Des quartiers colorés, violents, de maisons de jeux, de spectacles extraordinaires et de comportements audacieux. Certainement quelque chose comme Las Vegas, si l’on remplace David Copperfield par du théâtre kabuki.
Dans cet « underground » qu’étaient ces quartiers des plaisirs, les statuts officiels importaient peu. Ce qui comptait avant tout était d’avoir du fric et d’être « en vue ». il existait alors un mot pour l’idéal Edo du « people » : tsuu. Si l’on était tsuu, on savait quels clandés et quels bouges avaient le plus de classe, et comment l’on devait y agir. On pouvait arriver dans un bar, griffonner un haiku (poème japonais) alambiqué, torcher quelques bouteilles du meilleur saké sans pour autant être bourré, puis sortir avec les plus jolies filles (ou coucher avec les putes les plus recherchées). Si Dean Martin avait été un « Edokko », - un enfant d’Edo – il aurait été tsuu, ce qui importait largement plus qu’une position officielle dans les quartiers chauds de l’époque.
Et c’est précisément dans ce milieu qu’est né le sumo. L’un des spectacles de cet underground était les paris sur les combats de rue, dont les protagonistes étaient bien souvent des samurai en rupture de ban ou des migrants de la campagne. Il est tout à fait vrai que la lutte a une histoire séculaire au Japon, et fait même partie de la mythologie de ses origines. Temples et sanctuaires engageaient souvent ces hommes forts pour combattre dans leurs enceintes, un moyen comme un autre de faire de l’argent, leur donnant une relation avec la religion. Mais qu’on ne s’y trompe pas : ces combats étaient de rudes, âpres, brutales compétitions, qui se terminaient parfois par la mort d’un des protagonistes.
Mais à l’aube du 19° siècle, le sumo subit une mutation complète. A l’époque, les sanglants combats de rue étaient en danger d’être interdits dans le cadre de la croisade moralisatrice des shogun de l’époque. Menés par le rejeton d’une famille influente d’Edo, qui revendiquait l’héritage des secrets du sumo qui reliait ce sport aux combats de cour du 12° siècle, une armée de promoteurs de combats fit du lobbying auprès du shogun pour qu’il laisse les combats se poursuivre. Le shogun se laissa convaincre, et bientôt des combats de sumo étaient même tenus en son château. Le sumo, désormais pris dans les filets de la religion semi-officielle du Japon, le shintoïsme, était complètement réhabilité comme représentation de l’esprit japonais. On demanda même aux lutteurs d’aller accueillir – ou intimider – le Commodore Matthew Perry et sa flotte de Bateaux Noirs qui mirent fin à des siècles d’isolationnisme japonais sous la férule des shogun.
Quand le sumo sortit de l’underground pour s’établir comme partie intégrante de la culture officielle, il a du absorber le système hiérarchique du Japon des shogun, qui s’est fossilisé en la hiérarchie qu’il connaît aujourd’hui. Et, étant donné que cette hiérarchisation héritée de l’ère Edo perdure dans le sumo alors qu’elle disparaît rapidement de la vie japonaise moderne, le sumo pourrait véritablement être devenu le creuset des valeurs japonaises que ses refondateurs du 18° siècle imaginaient.
C’est certain, la hiérarchie du sumo est moins figée que celle du Japon d’Edo : c’est une méritocratie, même si c’est une méritocratie de la violence. Mais il ne faut pas perdre de vue que les seigneurs de la guerre qui entamèrent le projet d’unité nationale, achevé par les shogun, n’étaient pas de grands nobles eux-mêmes. Ils étaient des brutes issus de milieux modestes, qui dominèrent le pays par la force et la ruse, à la manière des lutteurs dans leurs combats.
APRÈS: Le Chanko Nabe