L’Oyakata, le Kashira et Iki
Miki-san, le chroniqueur sportif du Yomiuri qui a arrangé mon séjour dans la heya, devait être absent hier, jour prévu pour mon arrivée par l’oyakata, et il a donc envoyé un de ses collègues, Usaoa-san, me prendre pour me déposer à la heya. Usaoa me rencontre à la station Ryogoku, près du Kokugikan, le stade et quartier général du sumo à Tokyo, d’où un apprenti lutteur doit m’accompagner jusqu’à la heya.
Usaoa me fait pénétrer dans un bureau encombré du Kokugikan, qui ressemble à n’importe quel bureau japonais : six plans de travail se faisant face par sections, des papiers partout, des rayonnages en métal et des meubles aux teintes années 50.
A l’arrière du cabinet se tient, assis derrière un bureau, un homme aux cheveux lisses, poivre et sel, porteur d’une cravate qui tranche avec son costume bleu marqué de ses initiales. Il ressemble à un directeur d’entreprise, apprêté pour la photo officielle dans son usine. Assis sur la table devant son bureau se tient un gros gars aux cheveux en brosse. Celui-ci ressemble, avec sa carrure massive engoncée dans un costume bleu roi à boutons dorés, à un videur d’une boîte de nuit surpeuplée.
Usaoa me fait asseoir devant l’homme assis derrière le bureau et prend un siège derrière moi, tout près du gorille.
« Donc, Miki-san me dit que vous voulez vivre la vie d’un rikishi » entame-t-il, se servant du mot japonais pour lutteur de sumo. « Ca me va, mais je veux juste m’assurer de quelques points… ».
A ce moment-là, en fait, j’ignore totalement qui est cet homme. Etant assis derrière un bureau du Kokugikan, j’imagine donc qu’il doit être un employé de la fédération de sumo. En fait, c’est l’oyakata, le patron, le maître de l’écurie de sumo où je dois me rendre. Peut-être Usaoa pensait que j’allais le reconnaître. Ou peut-être me l’avait-il expliqué en chemin et je l’avais mal compris. J’ai encore des lacunes en japonais.
L’oyakata poursuit. « Il faut que vous sachiez que les rikishi se lèvent très tôt. Pouvez vous vous lever avant même le soleil ? ».
« Bien sûr » réponds-je. Cette question est facile. Je viens juste d’arriver au Japon et en fait, le décalage horaire me fait encore me lever bien avant l’aube.
Question suivante. « Vous savez, les rikishi dorment sur un futon à même le sol, dans une grande chambre collective. Vous êtes capable d’en faire de même ? ».
« Okay ». Ca me parait très semblable à une auberge de jeunesse.
« Les rikishi ne mangent que deux fois par jour, le déjeuner et le dîner. Pas de petit-déjeuner. Vous devez être habitué à avoir trois repas. Pourrez vous faire avec deux seulement ? »
Là, c’est plus dur, mais, encore une fois, je réponds par l’affirmative. Je peux gérer la faim le matin pendant une semaine s’il le faut. Et, après tout, je veux avoir une expérience de première main de la vie que connaissent les rikishi.
« Savez vous ce que mangent les rikishi ? », me dit l’oyakata, annonçant le prochain défi. « Ils mangent du chanko-nabe. Pouvez vous manger du chanko-nabe ? ».
Je n’ai jamais essayé le chanko-nabe, mais j’en ai beaucoup entendu parler. Il s’agit du régime copieux, riche en protéines, de n’importe quel rikishi, un ragoût de bœuf, porc, poisson, poulet, tofu et je ne sais quoi d’autre, cuit dans un bouillon épais. Il n’y a pas franchement beaucoup de voies bien claires pour la reconversion des sumotori, qui quittent leur sport avec un corps massif qu’il leur faut gérer. L’une est de devenir oyakata et de démarrer sa propre écurie, voie très chère puisqu’il faut acheter une licence spéciale. Une autre est de devenir coiffeur de sumo. La troisième est d’ouvrir un restaurant de chanko-nabe.
Je n’ai jamais mangé de chanko-nabe, et le dit à l’oyakata quand il me demande si je pourrai le supporter. « Mais ça n’a pas l’air mal », dis-je, lui arrachant le premier sourire depuis le début de notre conversation.
Il poursuit sa litanie des choses qu’il me faudra faire si je veux vivre comme un lutteur de sumo. « Les rikishi portent le mawashi », dit-il, parlant de cette pièce de tissu façon couche-culotte dans laquelle les lutteurs se battent et s’entraînent. « Porterez vous un mawashi ? ».
Pour dire vrai, cela ne me tente pas vraiment, et je suis certain que cela ne sera pas très flatteur sur moi. Mais je veux que l’oyakata soit sûr que je le fais pour de vrai, et lui réponds donc, dans un japonais pour le moins approximatif « Si c’est ce que font les lutteurs, je le ferai ».
« C'est bon », me dit-il, m’expliquant que le gorille va m’accompagner à la heya. Après un bref dialogue final avec l’oyakata pour déterminer combien de temps je resterai (c’est toujours en cours, probablement une dizaine de jours max), Usaoa et moi-même suivons le gorille en dehors. Sur le chemin de la gare, celui-ci se présente sous le nom, ou plutôt le titre, de kashira. Il s’avère que c’est une sorte d’adjoint de l’oyakata. Il me dira plus tard qu’il a été un lutteur jusqu’à dix ans auparavant. Son shikona était alors Hananokuni.
A la gare, Usaoa nous quitte, le kashira m’achète un ticket et nous pénétrons à l’intérieur. Nous tombons alors sur un lutteur, ce qui me paraît assez normal à Ryogoku, le quartier du sumo de la ville. Mais il s’avère qu’il est de notre heya ; je crois qu’il est là pour nous accompagner. Le kashira me le présente comme étant Kitamura.
Kitamura est un bel homme, avec toutefois un début de cernes sous les yeux, portant un chignon allongé qui pointe sur le haut de son crâne et retombe vers l’avant. Il est vêtu d’un kimono violet et d’une large ceinture bleue, avec un téléphone mobile coincé à l’intérieur. Il n’est pas très grand, et le kimono qui recouvre son ventre qui dépasse de sa ceinture ne lui donne pas une allure ridicule. C’est un gars solide, pétant la forme.
Mais ses oreilles son affreuses. Couvertes de cicatrices et de protubérances, réduites à l’état de bourgeons atrophiés. Je suis sûr et certain que c’est du à son entraînement. Lorsque j’ai préparé ce projet d’étude, j’ai lu un ouvrage sur le lutteur hawaïen Takamiyama, premier rikishi non-japonais à avoir emporté un tournoi. Il y était expliqué comment Takamiyama a eu ses propres oreilles en chou-fleur : dans les mains des lutteurs expérimentés de son écurie quand ils étaient persuadés qu’il faisait preuve d’arrogance. Si l’oyakata m’avait dit : « Les rikishi finissent par avoir leurs oreilles réduites en une purée sanguinolente. Vous êtes prêt à avoir les oreilles dans cet état ? », c’est là que j’aurais refusé.
Mais il est trop tard pour ce type de pensées. Je suis déjà dans le train, coincé entre Kitamura et le kashira. Je bavarde avec ce dernier, qui m’interroge sur le type de nourritures japonaises que je suis capable de manger, jusqu’à ce que nous atteignions la gare d’Ogikubo, l’arrêt de la heya.
Il faut encore dix bonnes minutes de marche. Kitamura, qui a quitté le train à l’arrêt précédent, est déjà là. A l’intérieur, une douzaine de lutteurs sont autour du tatami. La plupart sont en survêtement ; l’un d’entre eux, toutefois, pour une raison indéterminée, ne porte qu’un short blanc. Tous ont un chignon allongé sur le crâne, et tous ont une carrure impressionnante. C’est comme si je venais de pénétrer dans un monde d’êtres sur-gonflés.
Le kashira m’extirpe de ce monde quelques instants pour me faire monter un escalier partant directement de l’alcôve d’entrée, endroit où, dans les maisons japonaises, les visiteurs laissent leurs chaussures. A l’étage se trouvent les appartements de l’oyakata et de son épouse. Le kashira me présente à celle-ci, qui porte un inquiétant bandage sur des bleus à sa pommette gauche.
Le kashira me ramène alors en bas, dans la chambre aux paillassons, où tour à tour chacun des lutteurs se présentent à moi. Je ne me rappelle aucun de leurs noms, mais je n’oublierai jamais cette sensation de me trouver en présence de tant de personnes aussi radicalement différentes, dans tous les aspects, de moi-même. Ils font tous une tête de plus que moi, pèsent quelque chose comme deux fois mon poids, sont tous asiatiques (l’un d’entre eux, je l’apprendrai par la suite, est Mongol) et ont tous la même coupe de cheveux, un style que la plupart des gens ne connaissent que par l’entremise des sketchs de John Belushi.
Dans Le Lion De Papier, où George Plimpton écrit sur son expérience d’entraînement en tant que débutant aux Lions de Detroit, celui-ci cachait le fait qu’il était écrivain et fut à même de garder ce secret un petit moment, jusqu’à ce que ses équipiers ne commencent à se demander pourquoi il se baladait en permanence avec un ordinateur portable. Pour ma part, il n’y a aucune chance que je puisse essayer de faire croire que j’appartiens à ce milieu.
Après qu’ils se sont présentés, deux gars me font descendre par un couloir au sol de béton nu et aux murs défraîchis, donnant sur des salles de bain empestant l’urine, puis une volée de marches m’amène dans l’une des chambres communes. Ils me montrent mon couchage, plié au sol. Tous sont avachis dans leurs propres lits, en dessous de l’amoncellement de leurs effets personnels. Tous ont une sorte de petit campement, avec leur propre télévision, une étagère avec des affaires de toilette et différentes choses, des CD, une statuette d’un doigt d’honneur, des photos de playmates, des canettes de bière. Pratiquement tout ce que l’on trouverait dans une chambre de jeune homme, simplement rassemblé ici dans le petit espace alloué dans cette grande chambre unique.
D’évidence, c’est l’heure de la sieste. Deux des gars dans la chambre s’endorment instantanément. L’un joue aux jeux vidéos sur sa télévision à écran plat avant de s’assoupir lui-même. J’en entends un parler au téléphone sous ses couvertures, puis quelques bips m’indiquent qu’il doit envoyer de textos. Je commence à prendre quelques notes, lorsque la porte s’entrouvre sur un mec maigre en survêtement de velours orange, mèches blondes et chaînes en or, porteur d’un attaché-case argenté et d’une boîte en carton. Me jetant un regard, il dit : « Harry Potter ? Vous êtes Harry Potter ? ». Il me demande si j’aime le sushi, d’une voix forte malgré les lutteurs endormis autour de moi. L’un d’eux se retourne et demande l’heure. Je m’aperçois pour la première fois qu’il dort avec un inhalateur de ventoline.
Le gars en orange s’assied sur le futon où j’étais assis à prendre des notes. Son téléphone se met alors à sonner. Il a alors une longue conversation que je ne peux suivre, et me pose des questions durant les blancs de sa conversation.
« Tu connais ? », me demande-t-il montrant le logo sur la boîte qu’il a apportée. Je ne connais pas.
A l’occasion d’une autre pause, il ouvre sa mallette et me montre un petit album photo, le genre que l’on a gratuitement avec le développement. Des photos de lui dans un bar, trinquant avec pas mal de femmes différentes, la plupart jeunes et jolies.
« Mon travail ». C’est en tombant sur une photo d’une vitrine emplie de photographies de beaux mecs japonais que je crois comprendre quel est son travail. C’est un gigolo. Les femmes le paient pour boire un verre avec lui.
En fait, il s’avère que j’ai en partie raison. Après son coup de téléphone, je lui demande quel est son métier, mais cette fois-ci il sort un classeur rempli d’illustrations produit. Il me fait alors son numéro : la première illustration montre une chaîne de vente du producteur, à travers distributeurs et revendeurs, jusqu’au consommateur. L’autre montre une flèche qui éradique tous les intermédiaires.
« Directement du producteur au consommateur ». Je ne suis pas bien sûr de ce qu’il peut vendre. Cela a l’air d’être une sorte de médicament breveté pour les problèmes intestinaux.
En une mixture d’anglais et de japonais, il m’explique qu’il travaille comme gigolo la nuit en complément, mais que son activité principale est son numéro de marketing.
« Beaucoup de travail » me dit-il « mais je suis riche ». Dans le cours de la conversation, j’apprendrai qu’il a été lui-même lutteur dix années auparavant. Au vu de ses oreilles en chou-fleur, je veux bien le croire. Maintenant, il vit à proximité, et passe parfois à la heya pour passer un moment.
Bientôt, les lutteurs commencent à bouger. Quelqu’un entre et commence à balayer, et je replie donc mon couchage pour descendre. En bas, un lutteur balaie, pendant que deux autres font un sort aux boites de chocolats que j’ai apportées en cadeau. Dans la cuisine, d’énormes marmites de ragoût cuisent, tandis que trois lutteurs coupent de gros quartiers de viande. Une glacière, qui contient deux poissons entiers longs comme mon bras, est posée par terre. Je demande si je peux aider, et devant le refus, je remonte pour écrire encore un peu. J’y suis encore à cet instant, prêt à redescendre pour manger.
APRÈS: Le Sekitori
Usaoa me fait pénétrer dans un bureau encombré du Kokugikan, qui ressemble à n’importe quel bureau japonais : six plans de travail se faisant face par sections, des papiers partout, des rayonnages en métal et des meubles aux teintes années 50.
A l’arrière du cabinet se tient, assis derrière un bureau, un homme aux cheveux lisses, poivre et sel, porteur d’une cravate qui tranche avec son costume bleu marqué de ses initiales. Il ressemble à un directeur d’entreprise, apprêté pour la photo officielle dans son usine. Assis sur la table devant son bureau se tient un gros gars aux cheveux en brosse. Celui-ci ressemble, avec sa carrure massive engoncée dans un costume bleu roi à boutons dorés, à un videur d’une boîte de nuit surpeuplée.
Usaoa me fait asseoir devant l’homme assis derrière le bureau et prend un siège derrière moi, tout près du gorille.
« Donc, Miki-san me dit que vous voulez vivre la vie d’un rikishi » entame-t-il, se servant du mot japonais pour lutteur de sumo. « Ca me va, mais je veux juste m’assurer de quelques points… ».
A ce moment-là, en fait, j’ignore totalement qui est cet homme. Etant assis derrière un bureau du Kokugikan, j’imagine donc qu’il doit être un employé de la fédération de sumo. En fait, c’est l’oyakata, le patron, le maître de l’écurie de sumo où je dois me rendre. Peut-être Usaoa pensait que j’allais le reconnaître. Ou peut-être me l’avait-il expliqué en chemin et je l’avais mal compris. J’ai encore des lacunes en japonais.
L’oyakata poursuit. « Il faut que vous sachiez que les rikishi se lèvent très tôt. Pouvez vous vous lever avant même le soleil ? ».
« Bien sûr » réponds-je. Cette question est facile. Je viens juste d’arriver au Japon et en fait, le décalage horaire me fait encore me lever bien avant l’aube.
Question suivante. « Vous savez, les rikishi dorment sur un futon à même le sol, dans une grande chambre collective. Vous êtes capable d’en faire de même ? ».
« Okay ». Ca me parait très semblable à une auberge de jeunesse.
« Les rikishi ne mangent que deux fois par jour, le déjeuner et le dîner. Pas de petit-déjeuner. Vous devez être habitué à avoir trois repas. Pourrez vous faire avec deux seulement ? »
Là, c’est plus dur, mais, encore une fois, je réponds par l’affirmative. Je peux gérer la faim le matin pendant une semaine s’il le faut. Et, après tout, je veux avoir une expérience de première main de la vie que connaissent les rikishi.
« Savez vous ce que mangent les rikishi ? », me dit l’oyakata, annonçant le prochain défi. « Ils mangent du chanko-nabe. Pouvez vous manger du chanko-nabe ? ».
Je n’ai jamais essayé le chanko-nabe, mais j’en ai beaucoup entendu parler. Il s’agit du régime copieux, riche en protéines, de n’importe quel rikishi, un ragoût de bœuf, porc, poisson, poulet, tofu et je ne sais quoi d’autre, cuit dans un bouillon épais. Il n’y a pas franchement beaucoup de voies bien claires pour la reconversion des sumotori, qui quittent leur sport avec un corps massif qu’il leur faut gérer. L’une est de devenir oyakata et de démarrer sa propre écurie, voie très chère puisqu’il faut acheter une licence spéciale. Une autre est de devenir coiffeur de sumo. La troisième est d’ouvrir un restaurant de chanko-nabe.
Je n’ai jamais mangé de chanko-nabe, et le dit à l’oyakata quand il me demande si je pourrai le supporter. « Mais ça n’a pas l’air mal », dis-je, lui arrachant le premier sourire depuis le début de notre conversation.
Il poursuit sa litanie des choses qu’il me faudra faire si je veux vivre comme un lutteur de sumo. « Les rikishi portent le mawashi », dit-il, parlant de cette pièce de tissu façon couche-culotte dans laquelle les lutteurs se battent et s’entraînent. « Porterez vous un mawashi ? ».
Pour dire vrai, cela ne me tente pas vraiment, et je suis certain que cela ne sera pas très flatteur sur moi. Mais je veux que l’oyakata soit sûr que je le fais pour de vrai, et lui réponds donc, dans un japonais pour le moins approximatif « Si c’est ce que font les lutteurs, je le ferai ».
« C'est bon », me dit-il, m’expliquant que le gorille va m’accompagner à la heya. Après un bref dialogue final avec l’oyakata pour déterminer combien de temps je resterai (c’est toujours en cours, probablement une dizaine de jours max), Usaoa et moi-même suivons le gorille en dehors. Sur le chemin de la gare, celui-ci se présente sous le nom, ou plutôt le titre, de kashira. Il s’avère que c’est une sorte d’adjoint de l’oyakata. Il me dira plus tard qu’il a été un lutteur jusqu’à dix ans auparavant. Son shikona était alors Hananokuni.
A la gare, Usaoa nous quitte, le kashira m’achète un ticket et nous pénétrons à l’intérieur. Nous tombons alors sur un lutteur, ce qui me paraît assez normal à Ryogoku, le quartier du sumo de la ville. Mais il s’avère qu’il est de notre heya ; je crois qu’il est là pour nous accompagner. Le kashira me le présente comme étant Kitamura.
Kitamura est un bel homme, avec toutefois un début de cernes sous les yeux, portant un chignon allongé qui pointe sur le haut de son crâne et retombe vers l’avant. Il est vêtu d’un kimono violet et d’une large ceinture bleue, avec un téléphone mobile coincé à l’intérieur. Il n’est pas très grand, et le kimono qui recouvre son ventre qui dépasse de sa ceinture ne lui donne pas une allure ridicule. C’est un gars solide, pétant la forme.
Mais ses oreilles son affreuses. Couvertes de cicatrices et de protubérances, réduites à l’état de bourgeons atrophiés. Je suis sûr et certain que c’est du à son entraînement. Lorsque j’ai préparé ce projet d’étude, j’ai lu un ouvrage sur le lutteur hawaïen Takamiyama, premier rikishi non-japonais à avoir emporté un tournoi. Il y était expliqué comment Takamiyama a eu ses propres oreilles en chou-fleur : dans les mains des lutteurs expérimentés de son écurie quand ils étaient persuadés qu’il faisait preuve d’arrogance. Si l’oyakata m’avait dit : « Les rikishi finissent par avoir leurs oreilles réduites en une purée sanguinolente. Vous êtes prêt à avoir les oreilles dans cet état ? », c’est là que j’aurais refusé.
Mais il est trop tard pour ce type de pensées. Je suis déjà dans le train, coincé entre Kitamura et le kashira. Je bavarde avec ce dernier, qui m’interroge sur le type de nourritures japonaises que je suis capable de manger, jusqu’à ce que nous atteignions la gare d’Ogikubo, l’arrêt de la heya.
Il faut encore dix bonnes minutes de marche. Kitamura, qui a quitté le train à l’arrêt précédent, est déjà là. A l’intérieur, une douzaine de lutteurs sont autour du tatami. La plupart sont en survêtement ; l’un d’entre eux, toutefois, pour une raison indéterminée, ne porte qu’un short blanc. Tous ont un chignon allongé sur le crâne, et tous ont une carrure impressionnante. C’est comme si je venais de pénétrer dans un monde d’êtres sur-gonflés.
Le kashira m’extirpe de ce monde quelques instants pour me faire monter un escalier partant directement de l’alcôve d’entrée, endroit où, dans les maisons japonaises, les visiteurs laissent leurs chaussures. A l’étage se trouvent les appartements de l’oyakata et de son épouse. Le kashira me présente à celle-ci, qui porte un inquiétant bandage sur des bleus à sa pommette gauche.
Le kashira me ramène alors en bas, dans la chambre aux paillassons, où tour à tour chacun des lutteurs se présentent à moi. Je ne me rappelle aucun de leurs noms, mais je n’oublierai jamais cette sensation de me trouver en présence de tant de personnes aussi radicalement différentes, dans tous les aspects, de moi-même. Ils font tous une tête de plus que moi, pèsent quelque chose comme deux fois mon poids, sont tous asiatiques (l’un d’entre eux, je l’apprendrai par la suite, est Mongol) et ont tous la même coupe de cheveux, un style que la plupart des gens ne connaissent que par l’entremise des sketchs de John Belushi.
Dans Le Lion De Papier, où George Plimpton écrit sur son expérience d’entraînement en tant que débutant aux Lions de Detroit, celui-ci cachait le fait qu’il était écrivain et fut à même de garder ce secret un petit moment, jusqu’à ce que ses équipiers ne commencent à se demander pourquoi il se baladait en permanence avec un ordinateur portable. Pour ma part, il n’y a aucune chance que je puisse essayer de faire croire que j’appartiens à ce milieu.
Après qu’ils se sont présentés, deux gars me font descendre par un couloir au sol de béton nu et aux murs défraîchis, donnant sur des salles de bain empestant l’urine, puis une volée de marches m’amène dans l’une des chambres communes. Ils me montrent mon couchage, plié au sol. Tous sont avachis dans leurs propres lits, en dessous de l’amoncellement de leurs effets personnels. Tous ont une sorte de petit campement, avec leur propre télévision, une étagère avec des affaires de toilette et différentes choses, des CD, une statuette d’un doigt d’honneur, des photos de playmates, des canettes de bière. Pratiquement tout ce que l’on trouverait dans une chambre de jeune homme, simplement rassemblé ici dans le petit espace alloué dans cette grande chambre unique.
D’évidence, c’est l’heure de la sieste. Deux des gars dans la chambre s’endorment instantanément. L’un joue aux jeux vidéos sur sa télévision à écran plat avant de s’assoupir lui-même. J’en entends un parler au téléphone sous ses couvertures, puis quelques bips m’indiquent qu’il doit envoyer de textos. Je commence à prendre quelques notes, lorsque la porte s’entrouvre sur un mec maigre en survêtement de velours orange, mèches blondes et chaînes en or, porteur d’un attaché-case argenté et d’une boîte en carton. Me jetant un regard, il dit : « Harry Potter ? Vous êtes Harry Potter ? ». Il me demande si j’aime le sushi, d’une voix forte malgré les lutteurs endormis autour de moi. L’un d’eux se retourne et demande l’heure. Je m’aperçois pour la première fois qu’il dort avec un inhalateur de ventoline.
Le gars en orange s’assied sur le futon où j’étais assis à prendre des notes. Son téléphone se met alors à sonner. Il a alors une longue conversation que je ne peux suivre, et me pose des questions durant les blancs de sa conversation.
« Tu connais ? », me demande-t-il montrant le logo sur la boîte qu’il a apportée. Je ne connais pas.
A l’occasion d’une autre pause, il ouvre sa mallette et me montre un petit album photo, le genre que l’on a gratuitement avec le développement. Des photos de lui dans un bar, trinquant avec pas mal de femmes différentes, la plupart jeunes et jolies.
« Mon travail ». C’est en tombant sur une photo d’une vitrine emplie de photographies de beaux mecs japonais que je crois comprendre quel est son travail. C’est un gigolo. Les femmes le paient pour boire un verre avec lui.
En fait, il s’avère que j’ai en partie raison. Après son coup de téléphone, je lui demande quel est son métier, mais cette fois-ci il sort un classeur rempli d’illustrations produit. Il me fait alors son numéro : la première illustration montre une chaîne de vente du producteur, à travers distributeurs et revendeurs, jusqu’au consommateur. L’autre montre une flèche qui éradique tous les intermédiaires.
« Directement du producteur au consommateur ». Je ne suis pas bien sûr de ce qu’il peut vendre. Cela a l’air d’être une sorte de médicament breveté pour les problèmes intestinaux.
En une mixture d’anglais et de japonais, il m’explique qu’il travaille comme gigolo la nuit en complément, mais que son activité principale est son numéro de marketing.
« Beaucoup de travail » me dit-il « mais je suis riche ». Dans le cours de la conversation, j’apprendrai qu’il a été lui-même lutteur dix années auparavant. Au vu de ses oreilles en chou-fleur, je veux bien le croire. Maintenant, il vit à proximité, et passe parfois à la heya pour passer un moment.
Bientôt, les lutteurs commencent à bouger. Quelqu’un entre et commence à balayer, et je replie donc mon couchage pour descendre. En bas, un lutteur balaie, pendant que deux autres font un sort aux boites de chocolats que j’ai apportées en cadeau. Dans la cuisine, d’énormes marmites de ragoût cuisent, tandis que trois lutteurs coupent de gros quartiers de viande. Une glacière, qui contient deux poissons entiers longs comme mon bras, est posée par terre. Je demande si je peux aider, et devant le refus, je remonte pour écrire encore un peu. J’y suis encore à cet instant, prêt à redescendre pour manger.
APRÈS: Le Sekitori
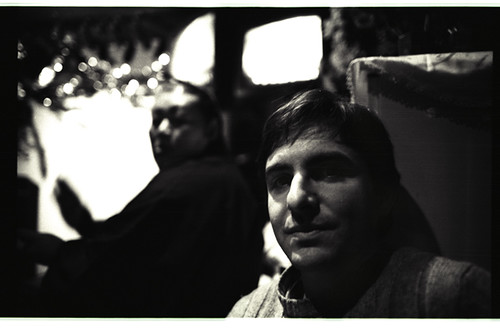


<< Home