Le Sekitori
L’idée que les sumotori puissent engraisser en mangeant des sashimi élaborés et du bœuf de Kobe, avec de temps à autres quelques tranches de foie gras pour le dépaysement, est séduisante. Elle est cependant à des années-lumière de la vérité. Le régime des sumotori n’est vraiment pas quelque chose d’enviable.
J’ai ma première expérience du menu sumo le vendredi soir, quelques heures après mon arrivée dans la heya. Une fois achevée la sieste de l’après midi, les lutteurs arrivent peu à peu dans la salle commune. Trois tables rondes sont disposées là. Comme on me demande de m’asseoir, je prends place à la table de celui dont je découvrirai un peu plus tard qu’il est le Gyoji.
Les Gyoji sont les arbitres du sumo. Ils sont vêtus dans le style de l’aristocratie de l’ère Heia, d’un kimono chamarré et d’une coiffe laquée, et rendent leur verdict sur le dohyo en agitant l’éventail qu’ils portent. J’imaginais que les Gyoji étaient des hommes d’âge avancé, membres hauts placés de la hiérarchie du sumo. Mais le Gyoji assis à ma table est un gamin ; il ne doit pas avoir plus de 25 ans (je n’ai pas encore essayé de lui demander). Sa coupe de cheveux est courte et classique, et il porte jeans et pull, comme n’importe quel jeune japonais, sauf que, à l’instar de tous les Gyoji, il vit avec les lutteurs dans la heya auquel il appartient.
Nous sommes rejoints à table par le Yobidashi, qui, me paraissant encore plus jeune, m’estomaque encore plus. Les Yobidashi sont les hérauts du sumo, qui proclament les noms des compétiteurs. Celui-ci, qui vit également au sein de la heya, ressemble à un frêle adolescent. Il porte des jeans foncés et un T-shirt noir sur lequel est inscrit « Scorpion Boy ».
Le Gyoji et le Yobidashi mangent tous deux rapidement, et quittent bientôt la table. Pour ma part, je mets plus de temps à avaler mon repas. Celui-ci consiste en des restes de chanko-nabe de l’après-midi : un brouet sombre et acide de miso (ndla : les nipponisants, je compte sur vous, je ne sais pas ce qu'est le miso…) où surnagent des morceaux de poisson plein d’arrêtes. Le chanko-nabe, comme je le découvre alors, n’est pas nécessairement le bouillon de viandes variées dont on m’a parlé. En fait, il se compose de n’importe quelle viande dont on dispose à l’instant, généralement d’une seule sorte. Nous mangeons aussi de petits poissons fumés et salés dont il faut retirer les arrêtes, de grosses tranches de lard très gras, et des pommes de terre baignant dans une sauce épaisse et grasse. Du moins j’imagine que ce sont des pommes de terre ; ce pourrait tout aussi bien être des morceaux de radis noir. C’est difficile à dire, car cela n’a aucun goût et la consistance est trop molle à cause du bouillon.
Les lutteurs ont un bon coup de fourchette, mais ne sont pas les Gargantua que l’on pourrait s’imaginer. Ils s’envoient tous un bol de soupe empli de riz, et au moins un bol de chacun des mets se trouvant sur la table. Mais cela ne semble pas si énorme, si l’on considère le volume de leur ventre.
Une fois le repas achevé, les tables sont débarrassées et posées contre les murs, et tout le monde s’affale sur le sol pour regarder la télévision. L’un des lutteurs s’approche alors de moi et me dit : « viens avec moi. Il y a une autre personne que tu dois rencontrer. C’est un Sekitori ».
Les sekitori rassemblent les rangs les plus élevés du sumo, du grand Champion, le Yokozuna, jusqu’aux juryo. L’unique sekitori de cette heya, un juryo, vit dans une chambre individuelle à laquelle mène un escalier privatif. En chemin, le lutteur qui m’accompagne me rend quelque peu nerveux « Ne dis que ‘mon nom est Jacob, yoroshiku onegaishimasu’ », les mots de présentation usuels. C’est à priori malvenu de s’en écarter lorsque l’on s’adresse à un sekitori.
Lorsque nous atteignons le haut des marches, nous trouvons, rassemblés sur le palier du Sekitori, quelques lutteurs. J’entre, et aperçois le Sekitori assis sur le sol de sa petite chambre, dans un kimono blanc entrebâillé, une console de jeux vidéos à ses genoux. Son regard est perçant, ses cheveux en bataille.
« mon nom est Jacob, yoroshiku onegaishimasu ».
Il me demande quel est mon âge, et je lui réponds que j’ai trente ans.
« c’est vieux », dit-il.
Il me demande alors combien de temps je suis censé rester.
« Environ une semaine »
« Allez vous mettre un mawashi et combattre pour de vrai ? »
« Peut-être ».
Sur ce, il me fait signe de m’en aller, et les lutteurs présents me font sortir de la pièce. En bas, je commence une conversation avec quelques lutteurs parmi les plus jeunes. Le seul non-japonais de la heya, un Mongol du nom de Batto, raille un autre lutteur japonais, complexé par son teint très mat, en le traitant d’Irakien.
« Regardes, c’est un Irakien, c’est le neveu d’Oussama ben Laden », répète-t-il à l’envi.
« Tes blagues mongoles ne sont pas drôles » lui réplique sa victime.
Après un moment, un autre lutteur, Takemura Hiroki (à ne pas confondre avec son jeune frère Takemura Tatsuya, autre lutteur de la heya), m’invite au sento, les bains publics japonais. J’y vais, appréhendant quelque peu qu’il puisse me demander de lui frotter le dos, ou pire, ayant entendu ce que les plus jeunes lutteurs avaient parfois à faire pour leurs aînés. Mais le refus des autres lutteurs des les aider en cuisine m’a indiqué d’ores et déjà que, contrairement à ce que l’oyakata a pu me dire, je ne serai pas tout à fait traité comme un apprenti lutteur. Et, de toute manière, ma plus grande crainte est maintenant de rentrer chez moi avec des oreilles en chou-fleur, alors…
Tatsuya et moi même frottons nos corps respectifs, et essayons de papoter, mais à l’instar de nombreux lutteurs, son accent est à la limite du compréhensible. Il me dit qu’il est d’une ville ouvrière du centre du Japon, à la criminalité importante (mais pas autant qu’une ville américaine, insiste-t-il). Lorsqu’il a eu 16 ans, un de ses professeurs de lycée qui connaissait l’oyakata l’a recommandé pour la heya, bien qu’il n’avait jamais lutté auparavant. Il a donc quitté l’école pour venir à Tokyo.
De retour à la heya, je passe le temps avec les lutteurs dans la salle commune. Ils regardent la télévision, se baladent avec leurs cellulaires, jouent avec leurs gameboy. Tout semble normal et apaisé, mais je suis toujours particulièrement conscient de la brutalité présente sous cet aspect bonhomme – ces gars, après tout vivent du combat. Leurs visages couverts de bleus, leurs yeux au beurre noir et leurs oreilles en chou-fleur ne semblent pas leur poser de problèmes : la douleur, lorsqu’on passe toutes ses journées à faire des reprises sur un dohyo, est un élément de la vie quotidienne. Mais leur style de vie, consistant à s’infliger l’un l’autre les pires douleurs toute la matinée, puis à se reposer béatement ensemble toute la soirée, leur donne l’aspect de membres d’un étrange monastère de la violence, une confrérie très hiérarchisée de bagarreurs de rue.
Bientôt, je vois certains d’entre eux sortir les futons de leurs placards, et je comprends dès lors que la pièce, qui sert déjà de réfectoire et de salon, s’apprête à devenir une chambre à coucher. Je remonte dans la plus petite pièce, où je suis installé, me rendant compte à présent que je suis logé avec les plus importants lutteurs (en dehors du sekitori) qui bénéficient d’un peu plus d’intimité, ont moins de colocataires et, plus important, ont la possibilité d’avoir pas mal d’affaires personnelles. Les inférieurs ne peuvent pas avoir grand chose car ils n’ont pas la place pour les mettre. Les gars d’en haut marquent leur territoire par l’accumulation d’affaires.
Personne n’est dans la chambre lorsque j’y arrive, et le chauffage est coupé. Je déplie alors mon futon et m’enroule dans la couverture pour me tenir chaud. Je m’endors sans même m’en rendre compte et dors comme une masse toute la nuit.
APRÈS: L’entraînement
J’ai ma première expérience du menu sumo le vendredi soir, quelques heures après mon arrivée dans la heya. Une fois achevée la sieste de l’après midi, les lutteurs arrivent peu à peu dans la salle commune. Trois tables rondes sont disposées là. Comme on me demande de m’asseoir, je prends place à la table de celui dont je découvrirai un peu plus tard qu’il est le Gyoji.
Les Gyoji sont les arbitres du sumo. Ils sont vêtus dans le style de l’aristocratie de l’ère Heia, d’un kimono chamarré et d’une coiffe laquée, et rendent leur verdict sur le dohyo en agitant l’éventail qu’ils portent. J’imaginais que les Gyoji étaient des hommes d’âge avancé, membres hauts placés de la hiérarchie du sumo. Mais le Gyoji assis à ma table est un gamin ; il ne doit pas avoir plus de 25 ans (je n’ai pas encore essayé de lui demander). Sa coupe de cheveux est courte et classique, et il porte jeans et pull, comme n’importe quel jeune japonais, sauf que, à l’instar de tous les Gyoji, il vit avec les lutteurs dans la heya auquel il appartient.
Nous sommes rejoints à table par le Yobidashi, qui, me paraissant encore plus jeune, m’estomaque encore plus. Les Yobidashi sont les hérauts du sumo, qui proclament les noms des compétiteurs. Celui-ci, qui vit également au sein de la heya, ressemble à un frêle adolescent. Il porte des jeans foncés et un T-shirt noir sur lequel est inscrit « Scorpion Boy ».
Le Gyoji et le Yobidashi mangent tous deux rapidement, et quittent bientôt la table. Pour ma part, je mets plus de temps à avaler mon repas. Celui-ci consiste en des restes de chanko-nabe de l’après-midi : un brouet sombre et acide de miso (ndla : les nipponisants, je compte sur vous, je ne sais pas ce qu'est le miso…) où surnagent des morceaux de poisson plein d’arrêtes. Le chanko-nabe, comme je le découvre alors, n’est pas nécessairement le bouillon de viandes variées dont on m’a parlé. En fait, il se compose de n’importe quelle viande dont on dispose à l’instant, généralement d’une seule sorte. Nous mangeons aussi de petits poissons fumés et salés dont il faut retirer les arrêtes, de grosses tranches de lard très gras, et des pommes de terre baignant dans une sauce épaisse et grasse. Du moins j’imagine que ce sont des pommes de terre ; ce pourrait tout aussi bien être des morceaux de radis noir. C’est difficile à dire, car cela n’a aucun goût et la consistance est trop molle à cause du bouillon.
Les lutteurs ont un bon coup de fourchette, mais ne sont pas les Gargantua que l’on pourrait s’imaginer. Ils s’envoient tous un bol de soupe empli de riz, et au moins un bol de chacun des mets se trouvant sur la table. Mais cela ne semble pas si énorme, si l’on considère le volume de leur ventre.
Une fois le repas achevé, les tables sont débarrassées et posées contre les murs, et tout le monde s’affale sur le sol pour regarder la télévision. L’un des lutteurs s’approche alors de moi et me dit : « viens avec moi. Il y a une autre personne que tu dois rencontrer. C’est un Sekitori ».
Les sekitori rassemblent les rangs les plus élevés du sumo, du grand Champion, le Yokozuna, jusqu’aux juryo. L’unique sekitori de cette heya, un juryo, vit dans une chambre individuelle à laquelle mène un escalier privatif. En chemin, le lutteur qui m’accompagne me rend quelque peu nerveux « Ne dis que ‘mon nom est Jacob, yoroshiku onegaishimasu’ », les mots de présentation usuels. C’est à priori malvenu de s’en écarter lorsque l’on s’adresse à un sekitori.
Lorsque nous atteignons le haut des marches, nous trouvons, rassemblés sur le palier du Sekitori, quelques lutteurs. J’entre, et aperçois le Sekitori assis sur le sol de sa petite chambre, dans un kimono blanc entrebâillé, une console de jeux vidéos à ses genoux. Son regard est perçant, ses cheveux en bataille.
« mon nom est Jacob, yoroshiku onegaishimasu ».
Il me demande quel est mon âge, et je lui réponds que j’ai trente ans.
« c’est vieux », dit-il.
Il me demande alors combien de temps je suis censé rester.
« Environ une semaine »
« Allez vous mettre un mawashi et combattre pour de vrai ? »
« Peut-être ».
Sur ce, il me fait signe de m’en aller, et les lutteurs présents me font sortir de la pièce. En bas, je commence une conversation avec quelques lutteurs parmi les plus jeunes. Le seul non-japonais de la heya, un Mongol du nom de Batto, raille un autre lutteur japonais, complexé par son teint très mat, en le traitant d’Irakien.
« Regardes, c’est un Irakien, c’est le neveu d’Oussama ben Laden », répète-t-il à l’envi.
« Tes blagues mongoles ne sont pas drôles » lui réplique sa victime.
Après un moment, un autre lutteur, Takemura Hiroki (à ne pas confondre avec son jeune frère Takemura Tatsuya, autre lutteur de la heya), m’invite au sento, les bains publics japonais. J’y vais, appréhendant quelque peu qu’il puisse me demander de lui frotter le dos, ou pire, ayant entendu ce que les plus jeunes lutteurs avaient parfois à faire pour leurs aînés. Mais le refus des autres lutteurs des les aider en cuisine m’a indiqué d’ores et déjà que, contrairement à ce que l’oyakata a pu me dire, je ne serai pas tout à fait traité comme un apprenti lutteur. Et, de toute manière, ma plus grande crainte est maintenant de rentrer chez moi avec des oreilles en chou-fleur, alors…
Tatsuya et moi même frottons nos corps respectifs, et essayons de papoter, mais à l’instar de nombreux lutteurs, son accent est à la limite du compréhensible. Il me dit qu’il est d’une ville ouvrière du centre du Japon, à la criminalité importante (mais pas autant qu’une ville américaine, insiste-t-il). Lorsqu’il a eu 16 ans, un de ses professeurs de lycée qui connaissait l’oyakata l’a recommandé pour la heya, bien qu’il n’avait jamais lutté auparavant. Il a donc quitté l’école pour venir à Tokyo.
De retour à la heya, je passe le temps avec les lutteurs dans la salle commune. Ils regardent la télévision, se baladent avec leurs cellulaires, jouent avec leurs gameboy. Tout semble normal et apaisé, mais je suis toujours particulièrement conscient de la brutalité présente sous cet aspect bonhomme – ces gars, après tout vivent du combat. Leurs visages couverts de bleus, leurs yeux au beurre noir et leurs oreilles en chou-fleur ne semblent pas leur poser de problèmes : la douleur, lorsqu’on passe toutes ses journées à faire des reprises sur un dohyo, est un élément de la vie quotidienne. Mais leur style de vie, consistant à s’infliger l’un l’autre les pires douleurs toute la matinée, puis à se reposer béatement ensemble toute la soirée, leur donne l’aspect de membres d’un étrange monastère de la violence, une confrérie très hiérarchisée de bagarreurs de rue.
Bientôt, je vois certains d’entre eux sortir les futons de leurs placards, et je comprends dès lors que la pièce, qui sert déjà de réfectoire et de salon, s’apprête à devenir une chambre à coucher. Je remonte dans la plus petite pièce, où je suis installé, me rendant compte à présent que je suis logé avec les plus importants lutteurs (en dehors du sekitori) qui bénéficient d’un peu plus d’intimité, ont moins de colocataires et, plus important, ont la possibilité d’avoir pas mal d’affaires personnelles. Les inférieurs ne peuvent pas avoir grand chose car ils n’ont pas la place pour les mettre. Les gars d’en haut marquent leur territoire par l’accumulation d’affaires.
Personne n’est dans la chambre lorsque j’y arrive, et le chauffage est coupé. Je déplie alors mon futon et m’enroule dans la couverture pour me tenir chaud. Je m’endors sans même m’en rendre compte et dors comme une masse toute la nuit.
APRÈS: L’entraînement
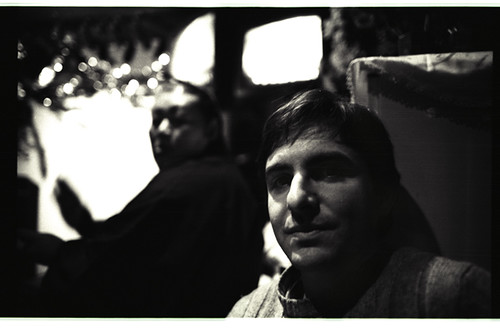


<< Home