Le Chanko Nabe

Mardi dernier, je ne me suis pas entraîné avec les autres lutteurs car mes jambes étaient encore particulièrement endolories de la séance de la veille. Mercredi, les lutteurs ont procédé à la réfection du dohyo à la place de l’entraînement, et jeudi la journée était chômée pour envoyer les banzuke. Donc, jeudi soir, la douleur ayant enfin consenti à quitter mes jambes, je me sens prêt à remonter sur le dohyo lorsque l’entraînement va reprendre demain matin. Je m’en ouvre à Tatsuya.
« Je ne pense pas que ça va être possible » me dit-il, à ma grand surprise. Comme tout le monde ici, il a été particulièrement serviable avec moi, me laissant participer à quasiment toutes les activités de la heya.
Mais il s’avère en fait que l’arrivée du banzuke marque le début d’une nouvelle étape dans la vie de la heya. Maintenant que tout le monde se situe dans la hiérarchie, il est grand temps que l’entraînement pour le tournoi de Janvier commence pour de bon. Des lutteurs d’autres heyas doivent se joindre à l’entraînement. Je serais tout simplement dans leurs pattes, me confie Tatsuya.
Pour être tout à fait honnête, il me faut reconnaître à cet instant que mon objectif initial de « m’entraîner une grosse semaine à devenir un sumotori » va avoir du mal à être atteint. Beaucoup de lutteurs rejoignent une heya sans rien connaître du sumo ; mais il apparaît aussi que tous passent leur six premiers mois de présence à l’école du sumo, au quartier général de Ryogoku, où sont enseignés les fondamentaux de la lutte. L’entraînement en heya se compose dans son intégralité de matches individuels déjantés, avec quelques instructions hurlées par les lutteurs anciens, le kashira et l’oyakata. Il n’est pas envisageable, pour le moins, que je puisse prendre part à de telles séances.
Mais j’ai toujours l’espoir que le reste du groupe ne partage pas la réticence de Tatsuya à me laisser m’entraîner avec eux, et qu’ils vont me laisser me mettre un mawashi dans la matinée pour les rejoindre. Je suis venu pour m’immerger dans la vie des sumotori, ce qui implique entre autres ces séances d’entraînement. Je suis donc bien décidé à y participer de nouveau, même si cela implique de passer encore une longue matinée à faire des shikos pour réchauffer la terre du dohyo.
Vendredi matin, je suis réveillé par les sons des lutteurs circulant dans la pièce. Murayoshi est en train de rouler son futon dans l’obscurité.
« Je peux m’entraîner avec vous aujourd’hui ? »
« C’est pas évident », me dit-il. « mais il est encore tôt », ajoute-t-il, impliquant que je ferais mieux de retourner dans mon lit. Dégageant mon réveil de mon fatras de fringues, livres et fils électriques, je constate qu’il n’est que 4h30. Et donc je me replonge dans mes draps.
J’émerge en me rendant compte que Moriyasu est en train de me parler. « Jacob, il est 7h00 ». Je bondis du lit, au moment où Murayoshi entre en mawashi.
Me voyant, il me demande « c’est vrai, tu voulais mettre le mawashi ».
« Je peux ? »
« Je crois que tu peux. Mais il y a beaucoup de monde en bas. Il n’y a vraiment pas de place pour toi ».
« Le kashira est en bas » poursuit-il. « Ce serait bien que tu descendes pour le saluer ». L’oyakata, le kashira, le sekitori et le tokoyama doivent tous être salués avec respect quand on les voit pour la première fois de la journée. « Assieds toi pour regarder l’entraînement et après on verra ».
Je descends au rez-de-chaussée et, après avoir salué le kashira, constate qu’il y a apparemment deux fois plus de lutteurs que d’habitude dans la salle d’entraînement. Je me résigne donc à rester observateur – plutôt qu’acteur – ce matin. Bientôt les oyakatas des deux autres heyas font leur entrée par la grande porte qui mène directement de l’extérieur dans la salle d’entraînement. Prenant chacun place sur un coussin, il attendent, assis à l’opposé du kashira.
L’un d’entre eux est un homme imposant, le cheveu court et taillé en brosse. On dirait qu’il appartient à la même mafia que le kashira (ndt : il s’agit de l’ancien yokozuna Onokuni). L’autre est grand et fin, les cheveux poivre et sel, habillé d’un pantalon de trekking Adidas et d’un manteau sombre. Il pourrait presque passer pour un entraîneur de foot européen.
Plus tard, j’apprendrai que ces oyakatas ont été des élèves de l’oyakata. Ils sont venus avec leurs lutteurs pour s’entraîner ici – plutôt que l’inverse – par respect pour leur ancien maître. L’une des deux heyas se trouve de l’autre côté de la ville et ses lutteurs doivent se lever à 3 heures du matin pour faire une heure de vélo avant d’arriver ici pour s’entraîner.
Les lutteurs des autres heyas sont, en moyenne, plus petits et « chétifs » que ceux d’ici. L’un d’entre eux est véritablement maigre ; pratiquement rien ne montre qu’il est un sumotori, si ce n’est ses cuisses et hanches très développées qui indique qu’il a fait son content de shikos. Ses cheveux – encore trop courts pour qu’il puisse en faire un chignon – montrent à l’évidence qu’il n’est pas dans le sumo depuis bien longtemps. Et pourtant, il bat une palanquée de lutteurs de notre heya à la file. Même Torii, l’un de nos lutteurs les plus imposants, doit s’employer contre ce petit bonhomme pour rester sur le dohyo, et perd même quelques matches.
Après un petit moment, toutefois, mes jambes croisées commencent à se raidir, et je commence à avoir du mal à me concentrer sur les combats, en ayant vu beaucoup ces derniers temps, et je décide donc d’aller voir ce qui se passe en cuisine. J’ai envie de voir comment se prépare le fameux chanko nabe.
Je sais que Takasaki doit être maintenant à la cuisine. Takasaki quitte la salle d’entraînement après s’être échauffé et avoir pris part à quelques corps à corps légers, pour aller préparer le repas. Il n’a pas effectué un véritable entraînement depuis presque un an et demi en raison d’une blessure à l’épaule qui l’a cantonné dans le rôle de chef cuisinier de la heya. C’est un lutteur trapu, carré, au teint presque rose, dont le haut du torse semble meurtrie en permanence d’avoir encaissé des charges sur le dohyo.
Quand j’entre dans la cuisine, Takasaki est en train de découper en morceaux un poulet à l’aide d’un couteau long et aplati, la poussière du dohyo toujours collée sur son dos. Des abats de poulet cru éclaboussent son mawashi – son seul vêtement du moment – quand il gratte de la carcasse tout ce qui peut en être comestible : le gras, le cartilage, les bouts de viande collés aux os. Il jette le tout dans une passoire qu’il a placée dans l’évier.
Torifumi, le lutteur que le sekitori appelle « Gu-Rauns », se trouve également dans la cuisine, en train de griller un Hokke entier – une sorte de maquereau – coupé en deux. Quittant le gril un moment, il verse du sake dans les deux grosses marmites d’eau en train de bouillir sur leur feu. Takasaki le rejoint avec sa passoire pleine de morceaux de poulet et en répartit le contenu à l’aide d’une louche. Un faux mouvement, et de l’eau bouillante éclabousse les cuisses nues de Torifumi. « Ouch », glapit-il.
A l’évidence, cela fait un bail que les deux lutteurs sont à l’ouvrage. en face des feux, on trouve une passoire pleine de légumes hachés : des carottes, une sorte de gros radis appelé daikon, des oignons. Une énorme passoire de chou, une autre emplie d’épinards et de champignons – des shitakes, de couleur brune, et de longues et fines bottes d’enokis.
Les accompagnements sont également prêts et posés à côté. Deux bols de natto – des germes de soja fermentés et gluants, qui exhalent une odeur de pied renfermé et ressemblent à de la morve – mélangés à de l’échalote. S’y ajoutent quatre plats de calmar cru coupés en bandes et marinant dans leur jus rosâtre.
Takasaki reste devant les plats, écumant le gras du poulet qui surnage, les flammes des brûleurs dangereusement près, me semble-t-il, des poils pubiens qui dépassent de son mawashi.
« Tu es en train de recopier la recette ? » me demande-t-il, en me voyant prendre des notes sur mon carnet.
« Bien sûr. C’est le chanko nabe ».
a ce moment, quelques autres lutteurs se trouvent également dans la cuisine, sans doute pour y trouver refuge du froid de la salle d’entraînement. Torii est assis sur la marche menant à la salle commune. Un lutteur gras, le cheveu rare, d’une autre heya, repose sur une serviette posée à même le sol, tel une version obèse du villageois risible qui requiert les services des Sept Samouraïs dans le film de Kurosawa. Batto et Saita se tiennent debout, à la chaleur des marmites d’eau bouillante, couverts de terre. Même le tokoyama, le coiffeur des sumotori, est présent. Il me demande si ça me dérange qu’il fume, puis s’en allume une et commence à faire des ronds de fumée dans la cuisine.
Tous partent d’un grand éclat de rire quand je dis « c’est du chanko nabe ».
« Il n’y a pas de plat qui s’appelle chanko nabe » m’informe Takasaki, revenant avec autorité sur les paroles d’un nombre incalculable d’amis japonais m’ayant décrit ce plat comme le délice du viandard : un épais ragoût de bœuf, porc, poisson et poulet, avec quelques morceaux de tofu et quelques légumes ajoutés pour faire bonne mesure. J’ai même pu lire au sujet de ce plat dans des livres sur le sumo, et en ai vu des recettes. J’ai pu voir – même si je n’y ai pas mangé – des restaurants de chanko nabe à Tokyo, tenus d’après ce que j’ai pu entendre par d’anciens sumotori.
Toutefois, sur la semaine que je viens de passer au sein de la heya, je n’ai jamais encore vu ce plat. Bien sûr, le plat principal de chaque déjeuner est un nabe (prononcer nah-bay), sorte de ragoût à la japonaise, que l’on fait mijoter sur la table, et dans lequel on ajoute en permanence des ingrédients frais. Mais il est peu fréquent d’y trouver plus d’une sorte de viande, et la base en change chaque jour. Parfois c’est du miso, parfois de la sauce soja, parfois cela a juste le goût d’un bouillon de poulet.
Malgré tout, j’imagine qu’il y a quelque chose dans ce nabe qui le rend « chanko », un tour de main ou un ingrédient particulier. J’ai tort.
« Le chanko nabe est un nabe fait par des sumotori » m’explique Takasaki, tout en écumant la graisse du poulet. « tout ce que des sumotori peuvent cuisiner, on l’appelle ‘chanko’ ».
puis il verse quelques cuillerées de sel dans chaque marmite, puis du poivre. Il y ajoute un peu de mirin – sorte de vin cuit – et un peu de kim-chi, une sauce piquante. Puis il répand ce que je crois être du sucre, mais encore une fois je me trompe.
« Non, c’est de l’ajinomoto » dit Takasaki, donnant le nom de la marque qui commercialise ce que chez nous nous appelons le glutamate de sodium.
« La poudre magique » ajoute Saita.
Takasaki poursuit la cuisson du nabe, ajoutant peu à peu du sel, du poivre, du mirin ou du kim-chi, avant de goûter le bouillon et de rajouter à nouveau de l’assaisonnement. Quand le bouillon est à son goût, il y verse les passoires de daikon et carottes, les répartissant dans les deux marmites.
En attendant l’ébullition, il donne à Torifumi – toujours en train de cuire le hokke – une tape amicale sur son ventre nu et rond.
Puis il ajoute les champignons shitake. Le reste des ingrédients – champignons enoki, épinards – doivent être ajoutés quand le nabe sera sur un brûleur de la salle commune, me dit-il.

Arrivé à cette heure, l’entraînement s’est achevé et les lutteurs pullulent dans la cuisine, picorant tout ce qui leur passe sous la main. Murayoshi teste une cuillerée du ragoût de nabe, et s’exclame « il n’a pas de goût », et ajoute encore quelques cuillers de kim-chi. Je surprends Moriyasu en train de chiper une tranche de pain dont je sais qu’il va aller se la griller dans sa chambre ; après treize ans passés dans la heya, il ne supporte plus le chanko, et mange donc du pain après l’entraînement pour se caler l’estomac avant de pouvoir rejoindre un restaurant.
Takasaki est toujours en train de touiller le nabe. Saita, qui se met un doigt sous l’aisselle, me dit : « Le voilà, l’ingrédient secret du chanko nabe : la sueur du sumo ».
APRÈS: Vous êtes Français ?
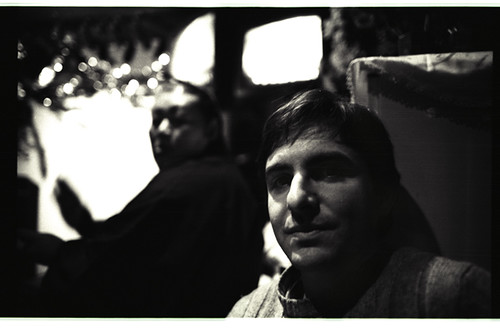


<< Home